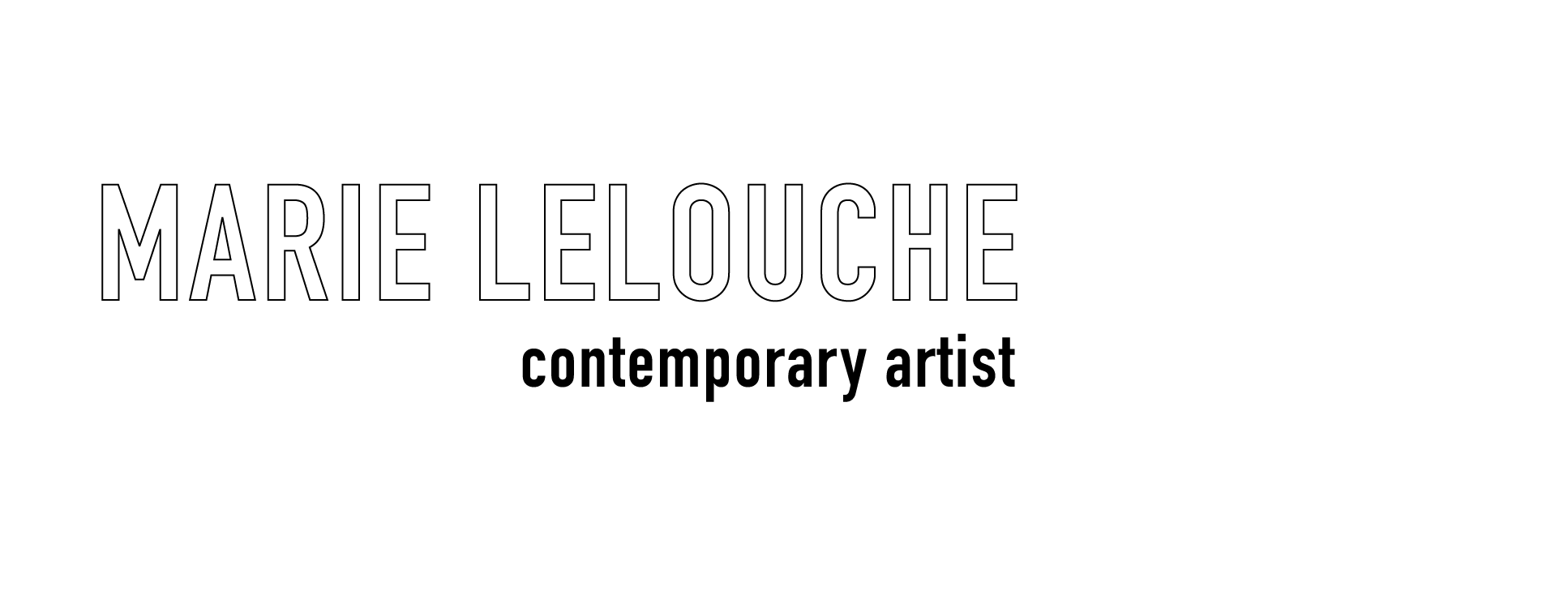BY SEPTEMBRE TIBERGHIEN
[FR]
Septembre Tiberghien propose un même protocole à chacune des artistes avec lesquelles elle s’entretient, dans le cadre de l’invitation éditoriale proposée par Thankyouforcoming : chaque rencontre est l’objet d’une discussion autour d’un texte choisi au préalable et qui porte un éclairage nouveau sur l’œuvre de l’artiste.
Assemblage
Le Sourire de Vénus (l’une des neuf nouvelles de J. G. Ballard, écrites entre 1955 et 1970, qui composent le recueil Vermilion Sands) raconte l’histoire d’une sculpture sonique envahissante, qui ne cesse de grandir et dont on essaie – en vain – de se débarrasser. Le personnage principal s’appelle Mr. Hamilton, possible référence à l’artiste Richard Hamilton, qui a réalisé la première œuvre pop, un collage daté de 1956 intitulé Just What is it that makes today’s homes so different, so appealing? réalisé pour l’affiche ou le catalogue de l’exposition This is Tomorrow à l’ICA de Londres. On sait que Ballard a visité cette exposition et qu’elle a eu une certaine influence sur lui. (1)
M.L. Je n’avais pas fait le rapprochement avec cette œuvre, dont je connaissais l’existence, mais pas le nom. D’avoir lu la nouvelle avec cette première image en tête doit t’avoir donné une impression totalement différente de la mienne. Quand j’ai lu Vermilion Sands, j’ai fait l’expérience de la matière, car il convoque beaucoup la couleur, les textures, ce qui résonne, et pour moi il n’y avait pratiquement pas de lien à l’image, alors que tu es passée par quelque chose de l’ordre du collage.
S.T. Il est de toute façon question d’assemblage dans cette nouvelle, puisque cette sculpture est décrite comme un répertoire condensé de ce qui se fait de plus kitsch en musique classique. Il y a quelque chose de déjà obsolète dans cette sculpture, que je trouve très intéressant et qui contraste avec l’idée qu’on se fait habituellement du progrès ou d’une vision futuriste de l’avenir.
M.L. Finalement, Ballard nous parle de la culture en général. À l’image du Pop art, qui a fini par s’insinuer dans tous les pores de la société et qui influence encore l’art d’aujourd’hui. Il y a à la fois un intérêt pour la sculpture et pour la culture en général dans ce texte. Ce qui rejoint ma pratique.
S.T. C’est très juste ce que tu dis par rapport au Pop art et à sa façon de s’infiltrer de manière tout à fait pernicieuse. Le Pop art est né en Angleterre d’une mère illégitime, le mouvement Dada et d’un père bâtard, la société de consommation des années 1950. La définition que fait Hamilton du pop art est intéressante en ce sens : « populaire, éphémère, jetable, bon marché, produit en masse, spirituel, sexy, plein d’astuces, fascinant et qui rapporte gros ».(2)
Je trouve que cette vision se retrouve condensée dans les nouvelles de Ballard et plus spécifiquement dans Vermilion Sands. On pourrait la développer, la déplier, chaque aspect est explicité d’une manière ou d’une autre. Il y a cet aspect séduisant du confort moderne, il y a aussi une décadence ; personne ne travaille, tout le monde est oisif. C’est le spleen du vingtième siècle ; les gens se laissent couler dans cette ambiance balnéaire, mais qui en même temps les rend anesthésiés.
M. L. Dans les discussions que nous avons eues avant de commencer cet entretien, je me posais beaucoup de questions par rapport au regard que je porte sur mes objets qui me paraissent toujours déjà obsolètes… et en même temps, je m’intéresse aux nouvelles technologies… Il y a ici une contradiction qui m’intéresse. Avec les Sculptures instantanées, je suis allée chercher des objets qui étaient déjà là et qui pour les gens sont presque de l’ordre de l’archive, puis de les tirer vers autre chose. Pour le projet que je développe actuellement, je suis en train de faire des « sculptures numériques » : à la base, des échantillons d’objets numérisés que je mixe, en gardant cette idée d’assemblage de morceaux déjà existants. Dans Le Sourire de Vénus, la sculpture est ce qu’on pourrait appeler aujourd’hui une « sculpture générative ». Il y a une forme de base, pas complètement terminée, décrite comme étant hideuse et qui va continuer à se développer. À plusieurs reprises, ils l’entaillent, ils la morcellent et elle continue à se développer jusqu’à ce qu’elle fusionne avec son environnement.
S.T. Et surtout avec l’architecture. Elle se diffuse comme un virus, en empruntant un mode de propagation très organique, alors qu’elle est conçue en métal, qui est normalement une matière inerte. Sa finalité est en effet de fusionner avec le monde, par une sorte d’osmose. C’est très ironique comme fin, il me semble, par rapport à notre vision globalisée de l’art aujourd’hui…
M.L. Il y a vraiment cette présence autour des gens qui vivent dans cet univers, sans qu’ils en aient conscience, car ce n’est pas identifiable. Il y a quelque chose de très insidieux et d’invisible. La façon dont les formes évoluent et disparaissent aux yeux de ceux qui les regardent, fait écho à ma pratique. Voir la construction de cette sculpture et sa disparition, c’est quelque chose de complètement fascinant pour moi.
M.L. Il y a une temporalité qui est très étrange en effet et ce qui m’a beaucoup marquée, c’est que cette nouvelle – Le Sourire de Vénus, mais on peut le dire des autres nouvelles qui forment le recueil Vermilion Sands – se place vraiment du côté du spectateur. C’est une observation dans le temps d’une sculpture. Certaines de nos conversations passées ont été animées par les mêmes intérêts. Ici on ne tourne peut-être pas autour de la sculpture, mais on vit avec.
Animisme
S.T. Oui, et c’est aussi la manière dont s’adresse la sculpture au spectateur qui est intéressante. Il décrit la sculpture comme une excroissance de son auteur. Comme si l’artiste avait adressé un dernier chant d’amour à son amant défunt par le biais de son œuvre. La façon dont la sculpture crie sa détresse témoigne de la vexation de son auteur envers une assistance et un public qui ne comprennent pas son travail. Il y a un aspect animiste dans cette sculpture, dans sa façon d’être habitée.
M.L. Je dirais même que c’est à l’œuvre dans toutes les formes que l’écrivain fait apparaître. Il y a toujours cette ambiguïté entre quelque chose qui nous apparaît de prime abord comme une sculpture avec les qualités qu’on lui attache et d’un seul coup, subtilement, il fait basculer les choses et on se retrouve du côté d’un organisme vivant. Dans toutes les nouvelles, il y a cette possibilité de basculement. Par contre, je ne me suis jamais posé cette question vis-à-vis de mon travail. J’essaie de créer du lien, car je pense toujours la place du spectateur dans les dispositifs que je crée bien sûr. Mais la différence, c’est que je ne vois jamais les choses sur le registre sentimental. Il y a de l’émotion, mais il n’y a pas ce qu’il met en place… avec la place de la femme, toujours assez étrange. Là c’est la femme créatrice, mais…
La muse
S.T. C’est toujours une femme fatale. C’est drôle ce que tu dis, parce que j’ai listé les noms des femmes dans chaque nouvelle et on se rend compte que ce sont presque des anagrammes. Comme s’il s’agissait d’un avatar. C’est toujours une seule et même personne qui se modifie, se métamorphose en fonction du contexte. On pourrait sans doute en cherchant identifier telle ou telle figure à une actrice ou à une vedette de l’époque. Dans la nouvelle Les Statues qui chantent, Lunora Goalen pourrait très bien être Peggy Guggenheim.
M.L. C’est très drôle parce que tu as noté les noms et moi j’ai noté la couleur de leurs yeux. Toutes ces femmes sont décrites par leur regard, par la couleur de leurs yeux. J’ai l’impression que c’est une clé qui permet de voir ses mondes à travers leurs yeux. Dès le début, ma propre rétine m’a semblée frappée par la couleur. C’est effectivement curieux la manière dont Ballard tourne autour d’une même femme, comme pour en explorer toutes les nuances.
S.T. Allez, je les énumère pour le plaisir : Jane Ciracyclides, Lorraine Drexel, Aurora Day, Gloria Tremayne, Lunora Goalen, Emerelda Garland, Hope Cunard, Leonora Chanel et Raine Channing.
M.L. Des noms de stars !
S.T. C’est vrai que le regard de ces femmes est très aqueux, comme un miroir qui réfléchit son environnement. Elles sont moins présentes à elles-mêmes que disposées à refléter l’autre.
M.L. Mais est-ce que ces femmes n’ont pas le rôle de la statuaire classique ? Elles sont impénétrables et finissent parfois par exploser en morceaux. Il y a tout ce que Ballard va greffer aux sculptures ou ce qui va émaner d’elles et, à côté, il y a ces femmes qui restent de marbre. De plus, ces femmes semblent toujours physiquement inaccessibles. Absentes, injoignables, introuvables dans Le Souvenir de Vénus et socialement inaccessibles dans Les Sculptures qui chantent. Il y a toujours une distance physique qui est maintenue avec la femme-statue. En revanche, il est toujours très proche des sculptures, jusqu’à être à l’intérieur de celles-ci. Il y a une inversion des statuts.
S.T. Il y a quelque chose de la muse, inspiratrice des arts. C’est assez proche de la vision qu’avaient les surréalistes de la femme, à la fois objet de désir et de contemplation, à maintenir à distance. Ballard a dit lui-même qu’il était très inspiré par Dali, qui a vécu toute sa vie une relation platonique avec son épouse Gala. La peinture de Dali et de Chirico est très présente. Avec ces femmes-statues sur des esplanades entourées de colonnades.
M.L. De plus avec ces tableaux qui se déplacent autour de cette femme, ce fameux ballet d’écran, il parvient de façon surprenante à parler de peinture. (3)
S.T. Oui, on rêve d’une version 2.0 de ce jeu des écrans.
M.L. C’est vrai et c’est exactement ce qu’on a fait avec Degré 360, puisqu’on a tourné autour de la sculpture avec nos images.
(Accéder à la publication au format PDF) C’est intéressant ce que tu dis, parce que si les femmes jouent le rôle de muse et que moi je les vois comme des sculptures, ça veut dire qu’il n’a pas rejoué sa propre fascination dans ses nouvelles. En effet ce sont les sculptures qu’il crée qui observent ces femmes. Quand il habite la sculpture, il observe de l’intérieur afin d’animer la sculpture mais pas seulement.
S.T. L’artiste produit un subterfuge. Il se glisse instinctivement dans la sculpture en pensant lui donner vie et la rendre plus attirante aux yeux de la collectionneuse et se retrouve piégé. Il se fait prendre à son propre jeu. Ce qui est intéressant c’est que cette sculpture devient une sorte de matrice. Si l’on tire le fil psychanalytique, c’est comme si l’artiste revenait au sein de sa création comme d’un giron originel.
M.L. Mais si je me souviens bien, elles sont toutes faites de métal ces sculptures. C’est un peu ce qui m’a refroidie, si je puis dire, dans ces nouvelles. Le métal c’est quelque chose de très souple, qui bouge, se dilate, mais aussi de très froid. Il n’est jamais passé par d’autres matériaux, ce qui m’a un peu surprise. Je me suis demandé si c’était lié à l’époque.
S.T. C’est possible. Si l’on pense à la sculpture moderniste que l’on retrouve dans les parcs en plein air dans les années 1950. Aujourd’hui ça nous paraît très daté et complètement désuet toutes ces sculptures en fer rouillé.
M.L. Par contre, cette façon de faire sonner ces sculptures métalliques, m’a beaucoup touchée. Pour la dernière pièce que j’ai faite, I’m walking in, il y a quelque chose de ce même rapport, mais avec une attention plus forte sur ce que les matériaux pouvaient apporter au son. Ici comme toutes les sculptures sont métalliques, j’ai entendu le même son tout au long de ma lecture. Je me suis donc dit qu’en comparaison au champ coloré qu’il utilise, c’est assez restreint. Il y a tout un imaginaire incroyable qui se déploie, par exemple, avec les insectes surmontés de pierres précieuses, qui est un assemblage assez inusité, même si on pense à Hubert Duprat et ses larves de trichoptères. Il y a quelque chose de réducteur alors que je n’ai pas ressenti ça dans le reste de l’ouvrage. Le métal m’est un peu apparu comme une contrainte.
S.T. Oui, en même temps avec le métal, il y a l’idée de ductilité dont tu as parlé tout à l’heure. Dans la première nouvelle, c’est grâce à cette propriété qu’on se rend compte que la sculpture prend de l’expansion et va jusqu’à percer une fenêtre pour rompre la frontière entre l’espace privé et l’espace public.
Balade sonore
M.L. C’est intrigant. Est-ce que toi, tu t’es fait un imaginaire sonore ?
S.T. Oui, j’entendais plutôt des sons électroniques, des bip bip d’ordinateurs, des choses comme cela.
M.L. Ah bon. Parce que sur ces paysages désertiques, je voyais en fait plutôt des bâtiments industriels. Ces sculptures métalliques ont fait apparaître un paysage sonore plutôt industriel. J’avais l’impression d’entendre des plaques vibrer. Comme lorsqu’on rapproche un haut-parleur d’une plaque de métal.
S.T. C’est difficile de sortir d’un son interne, qui vient de l’intérieur. Il y a ces fameux nodules sonores, qui poussent comme des branches avec des feuilles. C’est à ces nodules que sont rattachés des haut-parleurs qui diffusent le son. Comme si on pouvait entendre la sève qui circule dans les arbres. Le bruit de la poussée.
M.L. Et du coup, lorsque la sculpture est fondue et se mêle au reste de l’architecture, ces nodules disparaissent et on entre dans une certaine abstraction. Il y a quelque chose de toujours présent dans la matière, mais invisible.
S.T. Et il y a plutôt une question de rythme qui entre en compte et de vibration.
M.L. Comme dans les ponts suspendus qui ondulent au vent.
M.L. C’est étonnant à quel point Ballard est dans l’espace. Au fil d’une narration, arriver à rendre, à faire ressentir l’espace comme il le fait, c’est assez passionnant.
S.T. C’est vrai que par rapport à ta dernière pièce, c’est assez similaire, la manière dont lui nous balade dans cet univers onirique et désertique habité par ces sculptures de fiction, qui peuplent le paysage.
M.L. Elles habitent les lieux et elles appellent. C’est la différence avec ma pièce. Car si les spectateurs ne font pas l’effort de s’approcher, il ne se passe rien. Alors que dans l’univers de Ballard, les sculptures soniques sont envahissantes. Il y aussi quelque chose lié au fait que dans cette nouvelle, comme dans l’autre, les objets deviennent très vite obsolètes ou ringards. Il y a un effet de mode.
La survivance des formes
S.T. L’idée d’objets démodés amène l’idée du recyclage de formes anciennes. Faire du neuf avec du vieux.
M.L. Au-delà d’un recyclage conscient, il y a quelque chose qui subsiste des formes malgré nous. Comme dans la recherche entamée par l’Atlas Mnémosyne d’Aby Warburg. Quelque chose va persister après la fonte de la matière, mais on ne sait pas quoi exactement.
S.T. Je trouve qu’il y a de ça dans tes Sculptures instantanées. Des formes passées qui sont ré-assemblées pour en former de nouvelles. Il y a des parties non visibles, mais d’autres indices plus identifiables, qui permettent de reconnaître certains objets, même si le contexte n’est pas le même.
M.L. On peut les lire et ce sont ces parties là qui m’intéressent. C’est le cas de la sculpture dont nous avons parlé pour Degré 360.(4) Ce qui était très intéressant, c’est qu’il y avait des reliques d’œuvres des précédentes éditions, que le propriétaire avait conservées et qui étaient conditionnées par leur contexte de création. Les artistes étaient amenés à travailler en extérieur, donc ils ont utilisé des matériaux de grande échelle, qu’ils ont exploités au maximum, sans les recouper. Même si c’étaient des artistes avec des pratiques différentes et que les années ont passé, les proportions sont restées les mêmes. Il est resté un conditionnement des formes presque malgré eux, en raison du contexte de création, des modes de production de notre culture et des évolutions technologiques.
S.T. C’est finalement la question du style, qui varie indépendamment de l’autorité de l’auteur. Il y a un passage assez intéressant à cet égard dans la première nouvelle, lorsqu’après avoir essayé d’écorcher la sculpture sonique, le personnage se rend compte qu’elle grandit :
« Le plus étrange, commenta Raymond le lendemain matin, en élevant la voix pour dominer le vacarme, c’est que ça reste un Drexel.
– Une sculpture, tu veux dire ?
– Mieux que cela. Que tu en examines n’importe quelle partie, tu y retrouves la répétition des motifs originaux. Chaque aileron, chaque spirale a l’authentique style Drexel, presque comme si c’était elle qui les façonnait. D’accord, ce penchant pour les derniers compositeurs romantiques ne cadre pas très bien avec tous ces glapissements de sitar, mais il vaudrait mieux s’en réjouir, si tu veux mon avis. Tu ne vas probablement pas tarder à entendre du Beethoven… je parierais pour la Symphonie pastorale. (5)»
M.L. Oui, c’est la question de la survivance des choses.
S.T. Même si la sculpture se multiplie et continue à s’agrandir, elle garde « l’authentique » style Drexel.
Partition minimaliste
M.L. L’artiste avait prédit, planifié l’évolution des choses, c’est ce qui est intéressant. Pour moi, qui commence à travailler avec des dispositifs génératifs, c’est la création de partition. Il y a quelque chose qui persisterait au-delà de la forme qui serait de l’ordre du plan. C’est intéressant, surtout quand on s’intéresse aux technologies numériques et aux nouvelles façons d’archiver. On en revient à une forme de partition comme garant de l’œuvre et de sa conservation. C’est comme ça qu’est née la notion d’auteur, qu’on en est venu à protéger les œuvres légalement avec la notion de droits d’auteur. On pensait s’être émancipé de cela, mais finalement on y revient.
S.T. Est-ce que tu penses qu’un jour on arrivera à avoir des œuvres exclusivement immatérielles, qui seront réactivées à partir d’une partition, comme l’art minimal a pu proposer sa version avec des protocoles, comme Sol Lewitt.
M.L. Pour moi ce que Claude Rutault ou Sol Lewitt ont fait, c’est créer une partition pour que d’autres réalisent les œuvres, en quelque sorte, mais l’œuvre n’a pas été créée en amont. L’œuvre n’était pas préexistante au protocole, celui-ci signait son acte de naissance. Alors qu’aujourd’hui, j’ai l’impression qu’avec les outils de captation à notre disposition, les temporalités de création sont différentes. Souvent, cela modifie la façon dont l’œuvre va être perçue voire recréée par la suite. Le souci de conservation me semble plus que jamais marquer la création.
S.T. C’est vrai que dans la façon de considérer l’artiste, Sol Lewitt est le créateur et ses assistants demeurent des exécutants.
M.L. Mais au départ, ce n’était pas ses assistants qui exécutaient sa partition, il y en avait qui circulait dans les journaux. Alors qu’aujourd’hui, il y a des assistants attitrés.
S.T. Se pose la question de la transmission, à travers des corps et des gestes différents.
M.L. Oui et nous ramène à un acte culturel qui traverse énormément de sociétés. Quand un objet s’abîme, on essaie de le reproduire. La personne qui l’a fait essaie de passer le relais pour reproduire ce même objet, mais pas exactement, car le temps a passé, le contexte a changé. Si on parle d’un volume, il y aura peut-être une autre couleur sur le marché, mais c’est toujours le même objet, avec le même nom. Il y a ce qu’il reste, malgré le passage du temps.
Synesthesie
M.L. Je voudrais revenir sur le passage du livre dont tu as parlé tout à l’heure : lorsque les personnages de la nouvelle découpent la pièce, il n’y a pas de description des entailles, mais une description sonore. Je me demandais si l’auteur n’était pas profondément synesthésique, parce qu’il arrive toujours à faire basculer les choses d’un sens à l’autre. On est dans l’espace et puis on bascule dans la couleur. On est dans un geste qui est de l’ordre plutôt de la forme et il le retranscrit par le son. Il y a une capacité à nous faire passer très subtilement d’un sens à un autre.
S.T. Et à maintenir tous ces sens en éveil. C’est très juste ce que tu dis et je trouve que ça se retrouve de façon très frappante dans une des nouvelles où il y a des maisons qui sont vivantes [Les mille rêves de Stellavista]. En fait, les maisons sont animées par des circuits électriques et gardent la trace des événements passés, comme une mémoire, et les font revivre aux locataires suivants.
Ballard compare à un moment les maisons statiques et celles qui ne le sont pas et en arrive à la conclusion que plus personne ne pourrait vivre sans. Les maisons aussi viennent capturer un état d’esprit.
M.L. Je trouve que l’écriture de Ballard est très actuelle, peut-être parce que nous sommes à cette étape de développement. On lie très facilement image et son, au quotidien, on sait qu’il y a des travaux qui sont en train de faire naître des objets odorants ou tactiles. Il y a des espaces qui sont équipés pour répondre. L’expérience de l’interprète, du spectateur, etc…forment des récits, qui sont faits de matières et de couleurs très différentes et qui finissent par composer autre chose.
Pornographie du futur
S.T. Ça me fait penser à une scène du film de Leos Carax, Holly Motors, où le personnage est recouvert de capteurs de mouvement. À un moment la scène vire au fantastique et bascule dans une imagerie de synthèse en 3D. Il y a quelque chose d’assez réaliste, mais en même temps l’absence de repère isole chaque geste pour le transposer dans une autre réalité.
M.L. Oui. On peut décider par exemple que le mouvement du coude est lié à tel son ou que celui de la tête émane l’image. Et pourtant c’est toujours basé sur le mouvement du corps. On a la possibilité de faire en sorte que les choses s’entremêlent.
Dans I’m walking in, il y avait cela, l’intérêt pour la superposition d’espaces, l’un lié à l’espace sonore, l’autre sculptural. C’était vraiment ce qui m’a motivée ; ces envies de passages de l’un à l’autre. Après il y a le dispositif mis en place, qui répond à des règles plus strictes. Il y a quelque chose de cet ordre chez Ballard et qui plane dans notre société en général. Ça a commencé par une superposition des écrans et c’est en train de glisser vers quelque chose de beaucoup plus multi-sensoriel.
S.T. Le corps demeure le meilleur réceptacle. Simplement on a aujourd’hui des outils pour le prolonger et pour sublimer certaines sensations.
M.L. On parle beaucoup d’extensions du corps, mais on pourrait aussi parler de morcellement. Je pourrais par exemple très bien décider de voir avec mon coude en posant une caméra à cet endroit de mon corps. Ça veut dire que j’ai la possibilité de détacher certains de mes sens. C’est comme si on pouvait choisir l’indépendance de chaque partie.
S.T. C’est assez fétichiste comme positionnement.
M.L. Pour moi, il y a quelque chose qui se joue à ce niveau là dans mon travail. Dans ce livre, la Fresh theory, il y a un passage où il est écrit : « la SF comme clé de lecture de l’art contemporain, la schizophrénie comme moteur ».(6)
S.T. Ballard : « L’environnement comporte bien plus de fictions et de fantasmes que ce qu’aucun de nous n’est capable d’isoler individuellement. »
« L’imagination a échoué à suivre le rythme des possibilités offertes par la technologie en tout genre. Le rôle de l’artiste est de connecter le monde de la science et le grand public, d’illuminer le monde réel pour l’homme ordinaire. »
La science-fiction n’est pas du côté du fantasme interplanétaire, mais du microcosme quotidien.
Septembre Tiberghien et Marie Lelouche pour thankyouforcoming, Décembre 2015.
Notes :
(1) Voir à ce propos le texte d’introduction de Valérie Mavridorakis, « Is There a Life on Earth ? : la SF et l’art, passage transatlantique » dans Valérie Mavridorakis (éd), Art et science-fiction : la Ballard Connection, Genève, éd. MAMCO, p. 9-44
(2) Dans une lettre à Alison et Peter Smithson datée du 16 Janvier 1957. Richard Hamilton, MoMA, NY
(3) Voir la nouvelle « Le jeu des écrans », dans Vermilion Sands, op.cit.
(4) Degré 360 est une collaboration initiée autour d’une sculpture de Marie Lelouche installée en plein air, dans le jardin des 5 sens et de formes premières, à Aix-en-Provence, dans le cadre d’une résidence avec VoyonsVoir. Suivant la dégradation naturelle de l’œuvre, une publication sous forme de journal est née, résultant des discussions entre l’artiste et moi-même. De l’œuvre il ne reste aujourd’hui rien hormis cette trace.
(5) J.G. Ballard, « Le Sourire de Vénus », dans Vermilion Sands, Éditions Tristram, 2013, p.34. (Première édition originale parue chez Berkley Books, Londres en 1971)
(6) M. O. Wahler, « Le réel : combien de couches ?», dans Fresh Théorie, Éditions Léo Scheer, 2007, p. 53, (Premier tirage 2005)