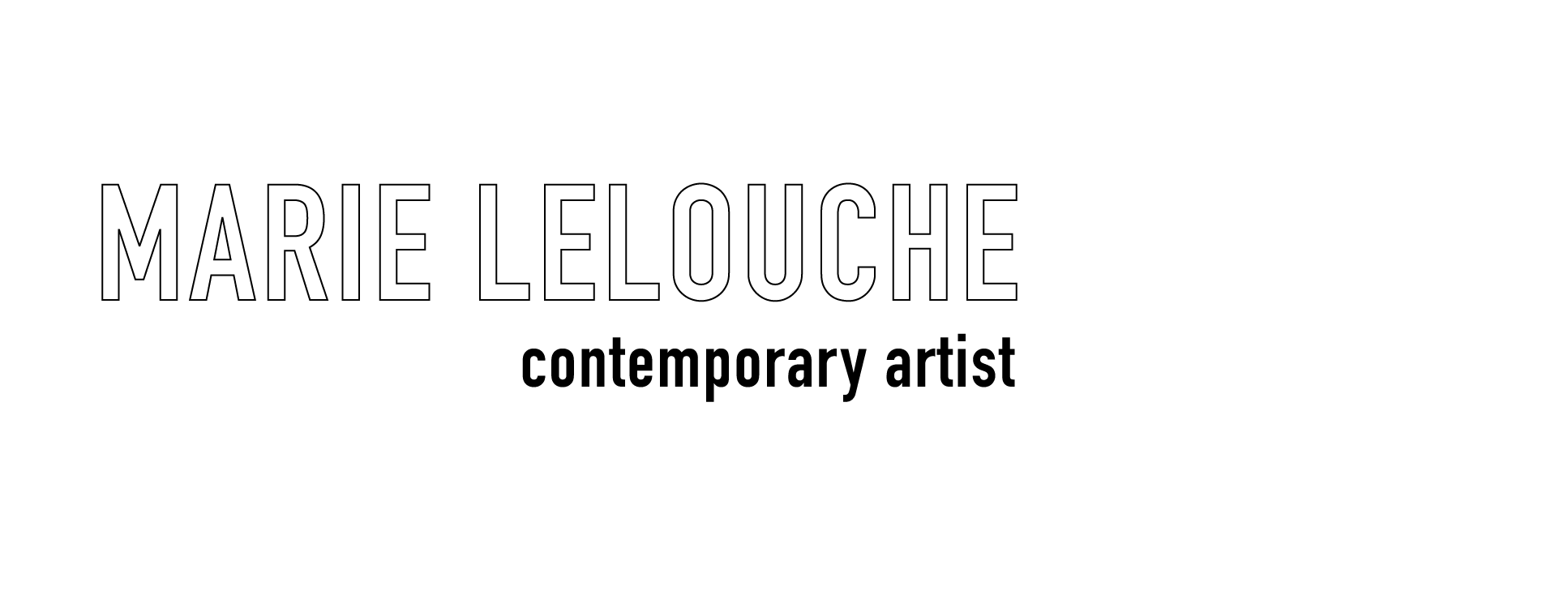by Septembre Tiberghien & Julien Verhaeghe
[fr]
a propos de sensibilite synthetique
Le travail de Marie Lelouche met en relief l’utilisation des outils d’enregistrement optique, de manière à questionner la nature de nos perceptions sensorielles. À mi-chemin entre le sensible de l’expérience et le monde environnant, les différentes propositions envisagent des processus de transfert d’une réalité à une autre. Si le passage de la tridimensionnalité à la bidimensionnalité apparaît, dans cette optique, comme une trame essentielle de son travail, il décrit surtout un motif susceptible d’enclencher d’autres façons de lire, de percevoir ou d’appréhender le monde, par exemple en sollicitant une dimension agissante, interactive ou temporelle. L’entretien qui suit a été réalisé à six mains, à la suite d’une rencontre publique organisée à la galerie Alberta Pane à Paris le 27 janvier 2018, à l’occasion de l’exposition Sensibilité Synthétique de Marie Lelouche.
ST : Dans le travail préparatoire à la discussion de ce soir, on s’était arrêtés sur la définition du mot virtuel, qui tend souvent à être assimilé de manière discutable à la « réalité virtuelle », mais qui pourrait aussi être entendu comme une potentialité. Or, je trouve intéressante cette place que tu laisses au spectateur dans ton œuvre Marie, en vertu de laquelle ce potentiel-là peut se développer comme une force agissant sur ton travail, plutôt qu’une volonté qui te serait propre. Pour en venir aux objets que l’on a ici sous les yeux et à ce travail que tu as développé dans le cadre de tes recherches au Fresnoy, peut-être qu’il serait bon d’introduire d’abord la manière dont tu prélèves des échantillons du réel pour ensuite les faire passer dans une autre réalité.
ML : Je travaille depuis 2015 avec un scanner tridimensionnel. Pour expliquer comment cela fonctionne et pourquoi j’avais envie d’utiliser cet outil, j’emploierai la comparaison avec un appareil photo numérique. Le photographe peut arpenter les rues, l’espace urbain pour enregistrer ce qui l’intéresse en quelques secondes sous forme de datas. Il peut en stocker un grand nombre sur sa carte mémoire, puis rentrer chez lui pour les visualiser, les retoucher, les découper, les imprimer… En ce qui concerne les pratiques du volume, de l’espace, c’est un peu plus compliqué. Je pourrais partir avec des bandes plâtrées pour mouler, enregistrer ces morceaux de bâtiments qui me passionnent et qui me touchent, mais il faut imaginer que les limites de cette technique se feraient très vite sentir tant les objets qui m’intéressent sont grands et dispersés. Lorsque j’ai découvert le scanner tridimensionnel, j’ai d’un seul coup eu accès à des formes qui depuis toujours me semblaient inaccessibles ; elles devenaient manipulables. Rodin aurait adoré employer le scanner pour composer de nouvelles pièces par assemblage, comme il l’a fait avec sa collection de moulages. Aujourd’hui, j’ai une collection de volumes, d’enregistrements digitaux que je travaille comme une matière première. Néanmoins, je dois avouer que l’image de ces volumes au travers de mon écran d’ordinateur ne me satisfait que partiellement et que je cherche en ce sens à les faire basculer à nouveau dans un espace où les spectateurs mobiles pourront en faire le tour.
JV : Tu évoques la notion d’« image », or, il y a cette trajectoire dans ton travail où on passe, dans un premier temps, par la volonté de capturer une portion tridimensionnelle de la réalité, d’un environnement, pour ensuite, dans un second temps, élaborer une sorte de mise à distance avec l’image qui en résulte. Pourrait-on dire, en cela, que tu adoptes une certaine posture vis-à-vis de l’image ?
ML : Tout à fait, cela vient sans doute de mon intérêt pour les modes de production des volumes – je parle de modes de production, car les techniques, les schèmes de pensée qui nous conduisent à créer en trois dimensions (voire plus) me paraissent très parlants et déterminants – ; or ces modes de production sont de plus en plus liés à des expériences visuelles et je dirais même à des dispositifs optiques. Dans un scanner tridimensionnel, il y a un objectif du même type que celui d’un appareil photo numérique qui, grâce à une série d’images, est capable de créer ce qu’on nomme une texture, ou un effet de surface d’un volume numérique. Il y a également un faisceau laser ou infrarouge qui enregistre un ensemble de coordonnées. Il est très troublant de penser que ces enregistrements de volumes sont, en définitive, uniquement liés au sens de la vue alors qu’il s’agit pour moi de chercher à appréhender, à comprendre l’espace. De plus, ces techniques nous obligent pour la plupart, ou nous permettent si nous prenons les choses plus positivement, à passer par une phase de travail bidimensionnelle, et pour poursuivre, à créer des ponts, des articulations entre plan et espace, image et volume.
ST : Le rapport au dessin, aussi, est important chez toi. Plus qu’une étape intermédiaire entre cette base de données que tu constitues grâce au scanner et la sculpture qui en est la matérialisation dans l’espace, le dessin est une trace du processus d’interprétation à l’œuvre il me semble. J’aimerais cependant revenir sur cet outil que tu décris comme étant optique et qui permet de multiples arrêts sur image. Il y a quelque chose de cinématographique, ou en tout cas de très cinétique dans ta manière d’agencer les images entre elles, de les monter si j’ose dire, pour donner une impression de mouvement figé. Par exemple, si on prend l’œuvre Blind Space, je trouve que ce découpage ou ce séquençage temporel est assez frappant, avec ces contours en gradin, qui semblent pourtant constituer un bloc homogène.
ML : Cette temporalité qu’offre l’outil d’enregistrement est en effet troublante. Aux trois dimensions que m’offre le travail en volume, s’ajoute une quatrième, celle du temps. Par ailleurs, cela est déjà à l’œuvre dans le processus de création, puisque les modes de visualisation offerts par l’interface de mon écran d’ordinateur me permettent d’animer les formes que je travaille, d’en faire le tour à partir d’un point fixe, de les traverser en plans de coupe successifs avant même de les avoir « produites ». L’objet à venir est déjà perçu à travers une séquence d’images que je choisis de conserver. J’ai aussi réfléchi à la possibilité de formuler un scénario sculptural, non en pensant la sculpture comme une forme qui devrait déployer une histoire, mais plutôt à la manière d’une expérience qui intègre une forme de « muabilité » (pour les sculptures instantanées par exemple), voire même en proposant une voix off qui ferait partie de la proposition (à l’œuvre dans Blind Sculpture, ou encore dans l’exposition Sensibilité Synthétique).
JV : Pour revenir à cette question de l’image, je me demande s’il n’est pas préférable d’évoquer la bidi- mensionnalité plutôt que l’image. Peut-être serait-ce alors plus fonctionnel dans la mesure où tu évoques des notions de volume et de tridimensionnalité, tandis que le dualisme ou la dichotomie que l’on peut établir avec la tridimensionnalité correspond davantage à la bidimensionnalité. De même, si malgré tout on devait parler d’image, on pourrait se demander de quoi ces images sont-elles les images, parce que les images dont il est question ne représentent pas des paysages ou des personnages, elles ne comportent pas non plus une dimension narrative ou fictionnelle. C’est, je crois, un aspect qui est au cœur de ton travail.
ML : C’est une bonne question, car lorsque j’ai commencé mes études, la principale problématique pour moi était de comprendre quel récit habite une sculpture. Je ne pense pas qu’il soit nécessaire qu’il y ait quelque chose de l’ordre du récit classique ou de la narration dans mon travail. Pour essayer de comprendre ce qu’il peut « contenir », je me suis beaucoup intéressée à des objets plus éloignés, notamment à ce qu’on appelle les arts premiers. Je cherchais à apprécier la distance que j’éprouvais avec ces objets, une distance attractive et repoussante à la fois. Finalement, le récit qu’ils portent m’était, et m’est toujours, trop éloigné pour que je puisse comprendre tout à fait ce qu’ils véhiculent. Qu’est-ce qui rend ces objets si fascinants pour moi ? Peut-être l’absence de récit clair, de message immédiatement décodable. Sans doute aussi l’impossibilité de comprendre comment la forme, l’usage, le discours ou les messages qui s’y rattachent ont réussi à s’y incarner dans un seul objet. Finalement, comment ce que l’on projette sur ces objets finit par combler le vide laissé par notre absence de lien avec leur histoire ?
JV : Avec Blind Sculpture, que tu as montré au Fresnoy puis au festival Mirage et bientôt à Venise chez Alberta Pane, tu as prélevé des fragments de l’espace public, des morceaux de la réalité quotidienne pourrait-on dire, c’est-à-dire des éléments relativement communs qui donc possèdent une dimension ordinaire, quelconque, ne serait-ce que du point de vue de la forme ou du matériau. En cela, peut-on dire que les éléments que tu prélèves s’inscrivent dans une sorte de neutralité ?
ST : Peut-être plutôt de « neutralisation » ? Je ne sais pas ce que tu entends exactement par neutralité Julien, mais selon moi, l’espace public est un patchwork qui est tout sauf neutre. Il y a une volonté politique dissimulée derrière chaque geste, à travers l’utilisation d’un mobilier urbain inconfortable pour éviter que les sans-abris ne dorment dessus, pour prendre le premier exemple qui me vient en tête… Ce qui, en revanche, est une forme de « neutralisation » des nuisances sonores, visuelles et olfactives.
ML : Les objets ou les espaces qui m’intéressent sont ceux que l’on a en partage. La rue imprime sur nous un répertoire de gestes. L’architecture oriente notre regard. Ces lieux que nous arpentons de manière supposément instinctive agissent sur notre perception, modèlent nos goûts, construisent inconsciemment notre esthétique. J’aimerai donner un autre exemple de ce que je nomme ces formes du commun : j’ai travaillé pour une pièce sur ce qu’on appelle des « flash-loading » (ce sont ces petites attentes circulaires composées par des dégradés de couleur qui, lorsqu’on attend que notre ordinateur accomplisse une tâche, tournent de manière plus ou moins continue). Ces formes étaient obsédantes pour moi. Nous les connaissons tous, les pratiquons autant qu’elles nous pratiquent et elles nous paraissent compréhensibles de façon tout à fait instinctive. Pourtant, j’ai ressenti la nécessité de les réinterroger.
ST : J’ai l’impression que ce que tu questionnes, c’est tout autant l’implicite d’un héritage culturel soi-disant universel qu’une forme de culture sensible qui agirait sur nous de manière plus insidieuse et moins rationnelle. ML : Oui, car ça passe par le sensible, par l’agir.
ST : En tout cas ta série de dessins Esthésie, présentées lors de l’exposition Sensibilité Synthétique, témoigne bien de cette quête. Il y a tout un travail de dénomination lié à la perte, à l’anesthésie du corps, qui est également présent dans le titre de l’exposition, Sensibilité synthétique, lequel suggère une forme d’artificialité des rapports humains. C’est assez paradoxal cette forme de neutralisation des affects, comme si tu te tenais à distance de ton propre travail, tout en y réinjectant çà et là du sensible, du palpable. Je pense qu’il y a quelque chose d’intéressant qui se joue là, dans ce rapport de dualité entre la virtualité et la sensorialité.
ML : Je crois que la neutralisation d’une certaine partie de ce que l’on perçoit peut nous permettre de réinterroger nos schémas de représentations. C’est comme si en nous privant momentanément d’un sens, nous étions en mesure de découvrir une forme, de la percevoir sans voile. Je crois que cet hypermédium qu’est le numérique nous offre cette opportunité, et je citerais d’ailleurs Marshall McLuhan qui me semble-t-il a parfaitement énoncé ce « mécanisme » : « Quand une nouvelle technologie taille dans une société, en effet, ce n’est pas la zone d’incision qui est la plus affectée. La zone d’incision et de choc est anesthésiée. C’est le système tout entier qui subit une transformation. La radio affecte la vision, la photo l’audition. Chaque nouveau choc déplace les rapports intersensoriels. »1 . Je crois que je cherche également à appliquer à nos sens cette sélection par fragment que j’opère sur les choses. Pour le dire autrement, je les pense de plus en plus comme possiblement orchestrables.
ST : Est-ce qu’au fond l’exposition ne serait pas devenue un super-médium, une nouvelle œuvre d’art totale ? En effet, pour Sensibilité Synthétique il y avait une pièce sonore qui accompagnait l’exposition, une bande audio dans laquelle tu décris les autres œuvres de l’exposition, en impliquant le corps et sa déambulation dans l’espace. Dans I Am Walking In ou Blind Sculpture il y a également ce recours au son comme l’utilisation d’un sens qui se surimposerait à la proposition. Je sais aussi que tu travailles pour le moment à un projet avec un chorégraphe/danseur…
ML : Oui en effet, mais je dirais que pour ces trois propositions, le son n’opérait pas de la même manière. Pour I Am Walking In, il s’agissait pour moi de perturber l’expérience sculpturale classique, de créer un espace disruptif en donnant à entendre, à proximité des sculptures, l’empreinte sonore interne du volume qui, paradoxalement, nous restera à jamais inaccessible par nos autres sens. Pour Blind Sculpture, des voix portent des récits qui ont été pensés dans leur contenu comme une suite d’histoires qui tourne autour d’un même sujet, la rencontre, mais dont la forme, c’est à dire la temporalité et le flux de parole, a été pensée comme le rythme de l’installation, celui du déplacement du spectateur. Pour Sensibilité Synthétique, la voix semble celle d’un interprète nous parlant de l’exposition en nous y incluant.
ST : Il y a un processus d’addition, en tout cas de superposition assez visible. Un mot qui est revenu souvent dans nos échanges, c’est celui de synesthésie : il y a rencontre et simultanéité de perceptions sensorielles, du point de vue de la réception, mais aussi de la production. On parlait tout à l’heure de l’outil d’enregistrement optique que tu utilises, j’ai l’impression que celui-ci te permet une extension des sens, de toucher littéralement du regard les choses ou les objets. C’est bel et bien un geste de sculpteur qui se saisit de la matière pour la modeler, sauf qu’ici la matière c’est de l’image.
ML : J’aime beaucoup cette idée de superposition ; comme si différentes couches sensorielles étaient présentes dans l’espace d’exposition, avec la possibilité de les traverser en totalité ou en partie, de passer avec fluidité de l’une à l’autre. C’est, je l’espère, ce qui se passe pour le spectateur avec Blind Sculpture. Alors que l’on perçoit au travers de l’écran ces formes qui s’agrègent dans un perpétuel mouvement de recomposition de la sculpture centrale, nous attrapons au vol les récits qui s’attachent à nous rendre ce que l’on voit étrangement présent. Comment mobiliser nos sens ? Par exemple, comme je le disais tout à l’heure, le texte est à la fois un ensemble de mots qui peut faire sens, mais aussi un rythme pour le déplacement. Ce texte n’est pas perceptible en permanence, car nos autres sens sont également sollicités. Nous basculons alors tour à tour de l’écran à l’espace ou de la vue à un rapport kinesthésique, sans qu’aucune couche sensorielle ne disparaisse.
JV : Cette sensibilité que tu évoques, la façon avec laquelle on prend la mesure de son environnement direct, à l’instar d’un animal qui exerce ses sens pour éprouver son environnement et survivre, est quelque chose qui s’adresse éminemment au corps. Le corps du spectateur est donc constamment sollicité. J’ai cependant le sentiment que tu pousses le raisonnement plus loin dans ta façon d’appréhender le corps, parce que le résultat formel de tes propositions renvoie à des univers, des structures ou des physionomies qui ne s’appuient sur aucune réalité préalable. Je dirais même qu’ils ont une apparence que l’on pourrait qualifier de science-fictionnelle, ne serait-ce parce que notre corps, nos yeux, nos sens, n’ont plus véritablement de repères, et qu’il faut alors opérer une sorte de travail de recomposition par l’esprit. En cela, c’est peut-être l’antithèse même d’un rapport corporel à l’œuvre.
ML : C’est une bonne remarque, parce qu’au contraire, je pense que c’est faire une proposition beaucoup plus sensorielle que de proposer quelque chose qui n’est pas « reconnaissable ». Parce que ce que l’on reconnait a déjà fait l’objet de projection de récit ou d’usage. Ce qui est par trop référencé peut faire barrière à mes sens. De manière tout à fait utopique et sans doute très naïve, je suis à la recherche de formes dont on peut faire une première lecture, ou plutôt, une lecture primaire. Et peut-être que dans une douce anesthésie de nos sens, je chercherais finalement à créer une amnésie partielle, ponctuelle qui nous ferait apparaître les formes comme neuves.
1. Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, Paris, Le Seuil, 1968.